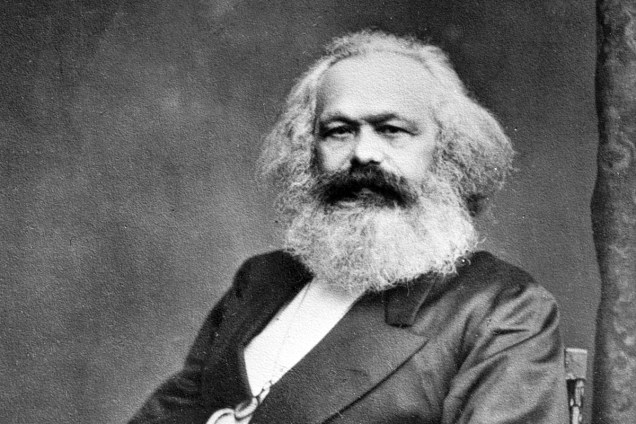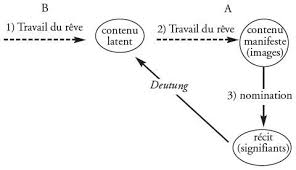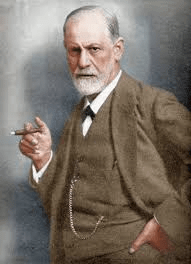Intervention à la 11ème journée de l’addictologie de Douai, le 27/09/2012
C’est un titre un peu en l’honneur de Marcel Czemak , lui qui nous avait fait un séminaire très intéressant pendant toute une année je crois sur une psychiatrie qui ne serait pas du semblant . L’intérêt, ce n’est pas de faire un texte à l’imitation de Marcel , c’est simplement de faire un travail sur le droit, sur la justice avec ce concept de J. Lacan : le Semblant
C’est vrai que les juristes n’ont pas ce signifiant là cela dit ils n’ignorent rien, bien sûr, mais ils n’ont pas « le concept »et ça, c’est à mettre au crédit de la psychanalyse lacanienne. Tout de suite,simplement,comme cela, en batifolant un peu, d’une justice qui ne serait pas du semblant , ça voudrait dire que la justice c’est du semblant, et ça, on l’admet facilement. Alors une justice qui ne serait pas du semblant, en utilisant le mot semblant comme ça, en langage ordinaire, et bien qu’est ce que cela serait pour vous, vous seriez tout de suite capables de répondre, et bien cela serait une justice qui serait totalement injuste,il faut dire ce qui est , là on condamnerait à mort à tout va , ça évoque les procès de Moscou, tous ces juges qui ne motivent pas leurs décisions et ce qui se passe actuellement, sous l’apellation des « peines plancher ». Enfin les petits voyous de banlieue on va les mater et les juges ne pourront plus avoir la liberté de prononcer la peine. Vous savez que les juges se sont révoltés parce que c’est leur attribution, la peine, entre un maximun et un minimun, et parfois le minimun c’est zéro parce que le juge estime qu’il n’y a pas à poursuivre. C’est cela qui tout de suite nous vient à l’idée.
Ensuite,qu’est ce qu’on va dire de la justice ? que le juge, que la justice, elle est rendue .Le juge rend la justice, alors un juriste extrêmement important, François Terré qui a fait un article là-dessus disant, on rend la justice, le juge rend la justice, il l’avait donc volée. Donc la justice aurait été volée au peuple et il faut la lui rendre. Voyez que les juristes ne manquent pas d’humour. Qu’est ce qu’on peut dire encore si on veut creuser un petit peu cette notion en jetant un coup d’oeil du coté de Lacan en étant un peu au milieu, ce serait de dire au fond , le juge, il rend la justice, mais quand il prend une décision, il fait un acte, la décision de justice, c’est un acte au sens de Lacan qui a dit que le testament était un acte, il est un acte au moment du décès, car on peut toujours révoquer un testament; jusqu’à l’heure de la mort le testament peut être révoqué mais à l’ultime minute là, il est un acte. Déjà cela nous permet de comprendre un peu les choses, c’est un acte et quand cet acte est lu, très souvent, il mécontente tout le monde .C’est à dire que la justice est assez délicate et cependant, une fois que l’arrêt est rendu, c’est terminé. On dira que par rapport au semblant , ça fait vrai, on dira ça comme ça, je dirais pas que c’est vrai, c’est difficile de dire que le droit et la vérité soient en coïncidence, pas du tout. Donc, c’est un faire, un faire vrai. Et là encore notre vocabulaire des concepts psychanalytiques et notamment ceux du semblant viennent éclairer le droit et l’éclairer même très bien. Parce que c’est vrai, bon, il n’y a plus de discussion, une fois que les appels sont terminés, car il y a toujours possibilité de faire appel d’une décision. Mais une fois qu’elle est rendue en dernier ressort, c’est fini. Voilà tout, tout le monde est d’accord et puis c’est tout.
Voilà donc ce qu’il y avait à dire , en entrée en matière. Le semblant, Lacan en parle la première fois dans le séminaire L’Angoisse , il en parle jusqu’à la fin, jusqu’au séminaire L’insu que sait. Et il en parle à propos de l’importance de l’homme, c’est à dire le fait pour un homme de faire semblant d’être homme, de faire l’homme. C’est ça pour lui le semblant, le faire- l’homme pour lui correspond du côté féminin à la mascarade. Donc cet aspect sexuel du semblant est tout à fait intéressant . Et nous prendrons des exemples de délits sexuels . Et je vous parlerais tout à l’heure du harcèlement sexuel puisque vous savez que l’article 322-33 du code pénal vient d’être annulé par le Conseil constitutionnel et que Monsieur Hollande déjà s’emploie à rétablir la loi et à réécrire la loi.
La justice , Lacan comme vous le savez en a parlé dans le Séminaire L’Envers de la psychanalyse mais là Lacan vise la justice institutionnelle , il est à la Faculté de Droit où il a été admis à faire ses conférences. Voyez la différence . Un « gosse » a le sentiment de la justice quand il dit : c’est injuste , même un petit môme, tout de suite, il vise l’ordre phallique, tout de suite, c’est à dire qu’il est lésé de ce côté là , surtout un garçon. Donc, là c’est une justice qui est une justice intérieure, puisque les philosophes connaissent bien , comme Kant , mais là ce n’est pas la philosophie qui nous intéresse, c’est vraiment l’institution visée par Lacan, l’institution judiciaire. Ce texte est intéressant parce qu’on peut se demander si c’est la justice qui précède la loi, le droit, puisqu’il assimile le droit, la loi, ou si c’est la loi qui serait avant la justice. Il y a là un problème intéressant. Il y a des anthropologues juristes qui ont pensé que le droit était né du juge.
Lire la suite →

 Philippe GUTTON considère Pierre MALE comme « le WINNICOTT de l’adolescence ». WINNICOTT (1896-1970) était pédiatre de formation, et analysé, entre autres par James STRACHEY et Michael BALINT, il a marqué la psychanalyse des enfants, notamment par la notion d’espace transitionnel. Membre du groupe dit des « indépendants », WINNICOTT s’est toujours tenu à l’écart de la querelle entre Mélanie KLEIN et Anna FREUD à propos de la psychanalyse des enfants, qui était alors l’apanage de l’école freudienne anglaise. En somme, dans l’institution analytique anglo-saxonne, il occupait une position tierce, neutre dans le sens où il ne participait pas aux différents théoriques mais avançait tranquillement ses propres conceptualisations issues d’une pratique assidue auprès des enfants. Une pratique qui justement, privilégiait la création d’un espace transitionnel, d’un lieu tiers entre l’enfant et ses parents.
Philippe GUTTON considère Pierre MALE comme « le WINNICOTT de l’adolescence ». WINNICOTT (1896-1970) était pédiatre de formation, et analysé, entre autres par James STRACHEY et Michael BALINT, il a marqué la psychanalyse des enfants, notamment par la notion d’espace transitionnel. Membre du groupe dit des « indépendants », WINNICOTT s’est toujours tenu à l’écart de la querelle entre Mélanie KLEIN et Anna FREUD à propos de la psychanalyse des enfants, qui était alors l’apanage de l’école freudienne anglaise. En somme, dans l’institution analytique anglo-saxonne, il occupait une position tierce, neutre dans le sens où il ne participait pas aux différents théoriques mais avançait tranquillement ses propres conceptualisations issues d’une pratique assidue auprès des enfants. Une pratique qui justement, privilégiait la création d’un espace transitionnel, d’un lieu tiers entre l’enfant et ses parents.