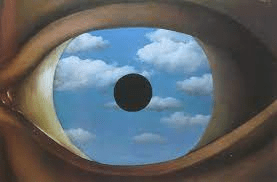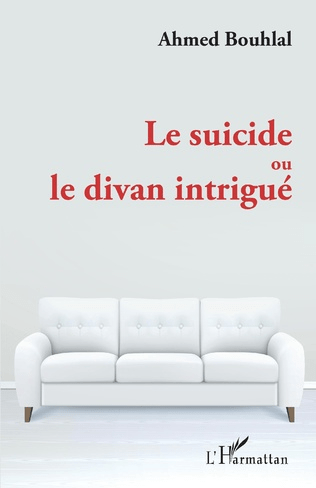Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a alerté, lundi, sur l’augmentation des prescriptions aux enfants et aux adolescents d’antidépresseurs et d’antipsychotiques notamment. Plusieurs pédopsychiatres s’offusquent d’une « diabolisation » des médicaments.
« Des dizaines de milliers d’enfants sous psychotropes », voilà l’un des points soulevés par un rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) – un organisme consultatif auprès du premier ministre. Intitulé « Quand les enfants vont mal, comment les aider », le rapport, paru lundi 13 mars, alertait sur la hausse de la consommation de psychotropes (médicaments utilisés pour soigner les troubles psychiques) chez les enfants et les adolescents. Un document qui a soulevé de nombreuses critiques de pédopsychiatres.
Selon le HCFEA, le besoin de soins augmente mais l’offre thérapeutique diminue, ce qui « favoriserait, par défaut, le soin par le médicament aux dépens des pyschothérapies ».Entre 2014 et 2021, la consommation de psychotropes chez les 6-17 ans aurait augmenté de 48,5 % pour les antipsychotiques, 62,6 % pour les antidépresseurs, 78 % pour les psychostimulants, 155,5 % pour les hypnotiques et sédatifs, selon le rapport, qui se base sur les données concernant la prescription.
OIivier Bonnot, pédopsychiatre au CHU de Nantes et secrétaire général du Collège national des universitaires de psychiatrie, dénonce un rapport « alarmiste »,ainsi qu’une « diabolisation des médicaments et une stigmatisation pour les jeunes qui en prennent ».
Sylviane Giampino, psychologue et présidente du conseil de l’enfance et de l’adolescence du HCFEA, assure, elle, que le rapport n’était pas à charge mais s’interrogeait sur « le déséquilibre entre les différents types d’aides ». « La consommationaugmenterait donc deux fois plus vite chez l’enfant que chez l’adulte »,souligne Mme Giampino, qui s’inquiète d’une prise de psychotropes « qui pourrait toucher 5 % de la population pédiatrique ». Une« donnée hypothétique » à mettre en perspective, « la prévalence des troubles mentaux chez les enfants étant autour de 20 % », nuance Diane Purper-Ouakil, pédopsychiatre au CHU de Montpellier.
Lire la suite →